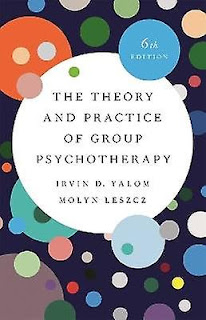Des fiches de lecture sur la psycho, et je raconte ma vie aussi. Présentation plus détaillée là : http://iedienpsycho.blogspot.fr/search/label/Pr%C3%A9sentation . Les commentaires (suggestions, précisions, critiques, louanges) sont plus que bienvenus (vous pouvez aussi me contacter sur iedienpsycho@gmail.com ). Mon site de thérapeute : https://www.gt-therapeuteacp-lyon.fr/
dimanche 30 juin 2024
30 juin 2024 - copier-coller d'un post de ma page Facebook
vendredi 28 juin 2024
Phenomenological research methods, de Clark Moustakas
Le courant de la psychothérapie humaniste se nourrit dans de nombreux domaines de la phénoménologie et, on peut le souhaiter, se préoccupe d'acquérir des connaissances donc de pratiquer la recherche. Dans l'exemple que je connais le mieux, l'Approche Centrée sur la Personne, la recherche positiviste (le principe, pour aller vite, est d'élaborer une hypothèse, de la vérifier avec une expérimentation, puis d'ajuster l'état des connaissances selon le résultat) a été pour beaucoup dans l'élaboration des fondamentaux, en particulier pour savoir quel type de relance avait quel effet. Pour autant, il y a une frustration aujourd'hui, en particulier au Royaume-Uni où le système de santé exige de mettre une solution en face d'une pathologie, de ne pas avoir d'outils à la fois reconnus et plus flexibles. La recherche phénoménologique est souvent citée comme une alternative à explorer, et il se trouve que le nom de Clark Moustakas revient souvent quand il est question de recherche phénoménologique.
Je m'intéresse de près à la recherche positiviste, y compris quand il s'agit d'explorer sa complexité ou ses limites, techniques ou matérielles, mais pour autant je n'arrivais pas à me représenter ce à quoi pouvait ressembler la recherche phénoménologique. Certes, comme le relève à juste titre l'auteur, faire disparaître la subjectivité est une ambition absurde (comparer des groupes "toutes choses égales par ailleurs" ne générera jamais un "toutes choses égales par ailleurs" absolu, la simple passation d'un questionnaire standardisé peut être influencée par la tenue du ou de la chercheur·se, le lieu, l'heure, ...), mais du point de vue positiviste, mettre la subjectivité au centre c'est presque contradictoire avec l'idée de recherche (le but est quand même en partie vérifier, d'arbitrer entre faits et opinions). Et si c'est bien de la recherche, quelle est la vraie différence avec une autre façon de faire de la recherche?
L'auteur commence d'ailleurs par évoquer les modèles de recherches plus qualitatifs qui s'en rapprochent, comme l'ethnographie. Et la différence sera parfois difficile à saisir : certes les sujets sont rebaptisés co-chercheurs, mais des questions leurs seront posées sur un sujet spécifique, questionnaire élaborée après une revue de littérature qui me semble tout ce qu'il y a de plus classique, puis les données seront traitées pour en faire une synthèse exploitable. Mais ces entretiens seront nourris des concepts de la phénoménologie, qui sont pour le moins complexes, comme le saura beaucoup trop toute personne qui a déjà cherché à comprendre Husserl ou Heidegger. Seront donc convoqués par exemple noeme (ce qui est perçu de l'objet, "non pas l'arbre mais l'apparence de l'arbre") et noese (le sens donné à l'objet, qui contient déjà une intentionnalité), l'intuition d'Husserl opposée à la déduction de Descartes, l'horizonalité (il n'y a pas de hiérarchie entre les propos tenus par le·a co-chercheur·se, donc comme l'horizon tout est potentiellement le point de départ d'une ligne infinie), l'Epoche ("les compréhensions, jugements, et connaissances du quotidien sont mis de côté, et les phénomènes sont revisités, avec un regard frais et naïf, dans le sens d'une ouverture totale, du point de vue d'un ego pur et transcendantal") (on ne compare pas à une chanson des Inconnus, ce serait méchant).
Du point de vue de la méthodologie pure, il s'agit de : commencer par atteindre cet état d'Epoche (présence réceptive et dénuée de biais), délimiter le sujet, donner une valeur identique à chaque propos (horizonalisation), délimiter des horizons ou des significations (identifier des invariants dans les propos recueillis), classer ces invariants par qualités ou thèmes, puis passer des descriptions texturales individuelles (intégration des invariants) aux descriptions texturales composites (regrouper les différents entretiens).
Malgré tous les efforts de l'auteur (je vous rassure, il y a aussi des exemples concrets!), la complexité est telle que j'ai bien du mal à saisir ce que cette méthodologie peut apporter de particulier, si elle est plus rigoureuse que les méthodologies déjà existantes qui s'appuient sur des entretiens non-directifs et semi-directifs, et surtout on fait comment pour engager un entretien (ou n'importe quoi d'autre) avec une présence dénuée de biais, saperlipopette de scrogneugneu! Vous l'aurez compris, le livre est dense, et rien n'interdit de retourner lire tel ou tel point pour mieux comprendre les spécificités de ce modèle qui a pour ambition de dépasser certaines limites de l'approche positiviste, en particulier, si j'ai bien compris, cette démarche de confirmer ou d'infirmer une hypothèse qui est en effet plutôt fermée. Je me pose peut-être plus de questions qu'avant de commencer, mais je sais aussi que je pourrais avoir les réponses, il faut juste que j'y passe beaucoup de temps. Et je pense qu'un·e étudiant·e ou chercheur·se en sciences humaines (anthropologie, sociologie, ...) qui maîtrise bien sa propre méthodologie pourra plus facilement identifier les différences et nourrir sa pratique.
vendredi 21 juin 2024
The Therapeutic Alliance. An Evidence-Based Guide to Practice, dirigé par J. Christopher Muran et Jacques P. Barber
L'alliance thérapeutique, c'est important, fonder sa pratique sur l'état de la science, ça l'est aussi. Sauf que la science a la qualité et le défaut d'être complexe, et les auteur·ice·s du livre s'engagent à fond dans cette complexité, au point qu'il aurait presque été préférable d'appeler le livre "an evidence-based guide to even more research", parce qu'il faudra déterrer les recommandations effectivement pratiques sous des montagnes d'info (les références bibliographiques occupent d'ailleurs un espace non-négligeable du livre).
De très nombreux aspects du sujet seront traités, que ce soit sur le contexte (thérapie individuelle, de couple -si de nombreuses recherches ont été faite sur l'influence du genre du ou de la thérapeute pour l'accompagnement de couples hétéro, les données manquent pour l'accompagnement de couples de même genre-, familiale, ...), l'approche théorique (humaniste -la mieux, en toute objectivité-, TCC, psychothérapie basée sur l'analyse fonctionnelle -qui a la spécificité de considérer que les incidents dans la relation thérapeutique font partie intégrante du travail thérapeutique-, ...) ou encore la multiplicité de ses enjeux (est-ce qu'une bonne alliance thérapeutique favorise le bon déroulement de la thérapie ou est-ce que c'est le bon déroulement de la thérapie qui favorise l'alliance thérapeutique, quel rôle a l'alliance thérapeutique selon qu'on se trouve au début ou au milieu du travail, quelles sont les conséquences d'une diminution de la qualité de l'alliance thérapeutique, ...), et même des réflexions sur comment former à l'alliance thérapeutique. Pour tous ces aspects, de très, très nombreux travaux seront présentés de façon critique, y compris des travaux présentant des conclusions contradictoires. Autant dire que pour le guide clefs en main pour intégrer des recommandations dans sa propre pratique, il faudra repasser... ou alors se rendre directement au dernier chapitre, synthèse pour le moins salutaire. A la décharge des auteur·ice·s, une bonne psychothérapie "consiste en substance en l'interaction de deux (ou plus) individus possédant différentes histoires, personnalités, style d'attachement ou approche des relations sociales, façons d'organiser leur expérience, attentes, et visions de la vie", ce qui fait beaucoup de paramètres.
Il y a quand même (ouf!) quelques recommandations concrètes, comme entrer en empathie plutôt que répondre la première fois que le·a patient·e exprime que quelque chose ne va pas (c'est un encouragement à se sentir libre de communiquer, et très souvent l'insatisfaction des patient·e·s n'est perçue que quand iels claquent la porte), ne pas se décourager si la métacommunication ne donne pas de résultats dans un premier temps (c'est une habitude à prendre dont l'efficacité s'ancre dans le temps), être vigilant·e quand la thérapie est très orientée sur la proposition de techniques, ce qui peut créer une distance, prendre explicitement la responsabilité de ses erreurs, être proactif·ve quand une colère du ou de la patient·e est perçue mais pas explicite, alors que le manque de soutien, la tendance à insister, trop de prudence, le changement fréquent de stratégie, l'erreur de diagnostic, le manque d'attention à l'influence de personnes extérieures sur le processus thérapeutique ou aux transferts et contre-transferts, vont plutôt, vous l'aurez a priori compris, être des obstacles.
Le livre est dense, très dense, donc je le recommanderais plutôt bien sûr aux chercheur·se·s ou aux personnes qui souhaitent faire un mémoire sur le sujet (il y a de quoi s'occuper!), ou aux personnes qui aiment particulièrement la complexité, mais pour les recommandations pratiques, s'il y en a, et de précieuses, ça peut être plus stratégique de s'orienter vers un autre ouvrage. Je suis convaincu (et j'espère!) que ce serait compliqué de trouver un·e thérapeute qui n'accorde pas à la relation thérapeutique une place centrale à son travail, mais sans être nécessairement motivé·e à rentrer dans ce niveau de complexité.
vendredi 7 juin 2024
The theory and practice of group psychotherapy, d'Irvin Yalom et Molyn Leszcz
L'intérêt d'Irvin Yalom pour la thérapie de groupe apparaît de façon pour le moins transparente dans la plupart de ses ouvrages. Récurrente dans les vignettes cliniques de son livre particulièrement marquant (et guide de lecture pour les suivants?) Thérapie existentielle, elle est même au centre de son roman La méthode Schopenhauer. Il aurait donc été insolite qu'il ne consacre pas un livre théorique à la thérapie de groupe, et d'ailleurs non seulement il consacre non pas un mais deux livres à ce thème, mais celui-ci en est à sa sixième édition (et fait 660 pages), l'importance que le sujet a pour lui est donc plutôt confirmée, et s'est maintenu sur le temps long.
(et, oui, j'ai fait dans cette intro comme si le co-auteur n'existait pas, mais en même temps qu'est-ce que j'y peux c'est lui qui a décidé de travailler avec Yalom)
Le texte est riche, toujours axé sur les applications pratiques, et l'argumentation est sourcée par de nombreuses références scientifiques. Le groupe a certes un intérêt économique (il n'y a plus besoin d'un·e thérapeute par client·e, préoccupation qui semble répondre à une inquiétude bien réelle pour les auteurs mais à laquelle j'ai eu un peu plus de mal à adhérer vu la vitesse à laquelle se remplit mon cabinet), mais c'est aussi un outil puissant, qui est parfois particulièrement complémentaire avec la thérapie individuelle, dans le sens où la rencontre a un énorme pouvoir thérapeutique et où en thérapie individuelle le·a client·e ne rencontre par définition qu'une personne, qui a le devoir de tenir une certaine posture contrairement aux autres membres du groupe. C'est d'ailleurs ces enjeux relationnels que les thérapeutes vont devoir à la fois permettre d'émerger, tout en s'assurant que les conditions restent sécurisantes (l'expression d'une colère par exemple peut libérer beaucoup de choses, pour la personne qui exprime la colère comme pour la personne qui la reçoit et même pour les autres membres du groupe, mais si la personne qui exprime la colère dépasse les limites qu'elle s'était fixée ou si la personne visée est tellement atteinte qu'elle ne peut pas répondre, l'incident sera au contraire anti-thérapeutique).
L'outil principal pour que les participant·e·s puissent sortir de leur zone de confort tout en évoluant dans un espace sécurisé, pour que les échanges même les plus intenses restent constructifs, est de resituer les interventions dans l'ici et maintenant, sujet auquel 70 pages du livre sont consacrées. Les thérapeutes redirigent l'attention vers le processus, la dimension relationnelle, les émotions ressenties. Par exemple, si A explose de colère parce que B arrive en retard, si C fond en larmes parce que D l'interrompt, l'important n'est pas de savoir pourquoi B est arrivé en retard ou si D avait de bonnes raisons d'interrompre C, mais ce qui a déclenché, spécifiquement dans l'interaction, la colère, l'interruption ou les larmes. Est-ce que A a déjà eu cette réaction dans d'autres situations? Comment est-ce qu'iel interprète les retards de B? Est-ce que c'est autre chose que B dégage, ou même un incident qui n'a rien à voir avec lui (des tensions non-dites dans le groupe, par exemple), qui a eu un effet si intense sur A?
Les thérapeutes ne sont pas des observateur·ice·s extérieur·e·s mais bien des participant·e·s à part entière et, le livre est clair, l'exercice peut être éprouvant. Les mouvements transférentiels sont souvent extrêmement parlants (Yalom déplore les reproches contradictoires qu'il a subis un jour où tout le groupe ou presque lui est tombé dessus), et peuvent être particulièrement intéressants lorsqu'il y a deux thérapeutes. En plus de la solidité nécessaire, les thérapeutes doivent savoir, comme le groupe est en train d'apprendre à le faire, exprimer leurs ressentis, en particulier quand un malaise émerge dans le groupe (tension avec un membre en particulier, non-dit autour d'un sujet spécifique, ...), en étant précis, authentiques (Yalom donne l'exemple du ou de la débutant·e qui félicite le groupe d'exprimer sa colère dans un moment où iel en prend plein la tête... le message, ostensiblement décalé avec le ressenti, aura peu de chances d'être entendu) et constructifs (exprimer un agacement contre une personne peut déverrouiller une situation bloquée, mais le commentaire ne doit pas être formulé comme un jugement, et bien sûr la personne visée doit pouvoir exprimer librement son ressenti).
En plus de ces précieux principes généraux, les auteurs donnent des indications spécifiques pour déterminer si une thérapie de groupe sera indiquée ou a priori néfaste pour une personne (une vigilance particulièrement importante selon eux, dans la mesure où une erreur impactera bien entendu la personne mais aussi le groupe dans son ensemble), les différents types de groupe (spécialisés, à distance, en institution, ...), la gestion des arrivées de nouvelles personnes et des départs, ou encore les façons productives d'intervenir face à certaines difficultés (un·e participant·e qui monopolise l'espace, qui demande souvent de l'aide avant de rejeter les interventions proposées, qui a une personnalité narcissique, ...).
Le livre est riche, complet, exigeant, et toujours rattaché à la pratique la plus concrète. C'est à la fois un plaidoyer efficace pour la thérapie de groupe et un guide exhaustif pour la mettre en pratique.