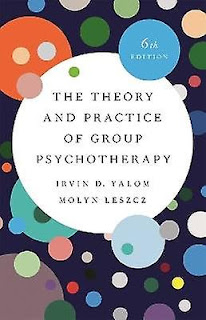Il y a un an tout pile, donc, je rendais mon casque et mon badge de chargé d'assistance auto, pour une révolution physiologique (fini le travail de nuit! je rejoins l'univers des gens qui dorment la nuit) et professionnelle, puisqu'enfin je passais pro, nouvelle façon d'ancrer que, oui, je suis thérapeute.
J'avais une énorme sensation d'euphorie, mais aussi beaucoup d'appréhensions. C'est peut-être une façon élégante de dire que j'avais beaucoup de représentations de la réalité, tout ayant fortement conscience que ce n'étaient que des représentations et que la réalité allait être mon souci principal, de façon très aiguë, dans les mois qui allaient arriver. Comme dit Lacan que je ne cite vraiment pas souvent, "le réel, c'est quand on se cogne", et il fallait trouver un équilibre entre limiter les risques d'impact et quand même me lancer un jour.
Certains aspects qui me faisaient peur ont été beaucoup moins insurmontables que ce que je me représentais. L'administratif en particulier, il y a eu des moments relou mais en faisant les choses une par une c'est passé, j'ai créé mon entreprise, souscrit à une assurance pro et un organisme de médiation, et découvert qu'éditer des factures une fois qu'on a fait la liste des mentions obligatoires (et qu'on a un logiciel adapté pour le faire) (j'ai utilisé Invoice Ninja puis Henrri, pour les curieux·ses) ça n'a absolument rien de compliqué. Bon, pour autant je ne suis vraiment pas prêt de changer de statut, et j'ai une énorme flemme de demander le CEP (surtout que je suis déjà adhérent à la FF2P donc j'ai déjà une preuve que ma formation correspond à des critères qualitatifs interprofessionnels), mais par rapport à la montagne que je m'en faisais, ça va!
Faire mon site était aussi un sujet d'inquiétude, mais si il y a eu beaucoup de réécritures, si ça a été un vrai travail, ça a aussi été un plaisir (merci Donatien pour les photos), les aspects techniques étaient largement gérables même avec mon niveau en informatique, et en plus j'ai un logo qui me met en extase à chaque fois que je le vois (merci Dor Hud).
Il y a aussi eu des demi-surprises. J'avais par exemple la conviction que, après avoir cumulé formation et travail en horaires décalés pendant 13 ans, j'allais enfin retrouver des horaires normaux. Certes c'est bien mieux qu'avant, mais ce n'est pas si simple. Être thérapeute à son compte, c'est évidemment recevoir des client·e·s, mais c'est aussi se former en autodidacte, se former pas en autodidacte (je vais bientôt ralentir sur cet aspect parce que le budget), s'occuper de sa visibilité ce qui peut recouvrir une infinité d'actions, ... Même quand le cabinet est vide ou presque, c'est un travail à plein temps, et surtout ça ne va pas toujours de soi de distinguer ce qui relève du travail et ce qui n'en relève pas. Lire ce livre ou regarder cette vidéo sur un sujet qui m'intéresse et qui a un lien avec la thérapie, travail ou non (quand ledit livre est un pavé ultra technique, évidemment c'est plutôt clair, quand c'est un roman autobiographique, ça l'est moins)? Quand je réponds au mail d'un·e ami·e que je connais dans le cadre de la formation, c'est de la vie sociale ou j'entretiens mon réseau? C'est une vraie libération de pouvoir gérer ses propres horaires plutôt que de composer avec le responsable grognon des plannings, mais c'est aussi un équilibrisme.
Autre demi-surprise, la différence entre la pratique en formation et la pratique réelle. J'avais dit sur ce blog que dans les 2-3 dernières années de la formation on passait de l'écoute des personnes qui se forment à l'ACP à l'écoute de personnes de l'extérieur... en fait, oui et non. Les personnes que j'ai suivies dans le cadre de la formation l'ont été pendant à peu près 2 ans, donc elles ont eu le temps de s'habituer à ce modèle de thérapie. Les personnes écoutées dans le cadre de mon bénévolat à SOS Amitié savaient où elles appelaient, et pour des raisons mathématiques la plupart n'en étaient pas à leur premier appel. C'est très différent de recevoir des personnes qui cherchent "un psy" avec l'infinité de représentations, sur ce qui peut être attendu comme sur la façon de travailler, que ça peut recouvrir. Et enchaîner les premières séances, avec l'ajustement des deux côtés que ça implique, c'est énormément de stress, surtout quand ça s'ajoute aux autres aspects stressants de l'installation.
Un aspect, en revanche, que j'avais largement sous-estimé (c'est peut-être un mal pour un bien, parce que je me serais lancé quand sinon?), c'est la difficulté à trouver des client·e·s. Pourtant c'est un sujet que je prenais au sérieux, puisque je l'avais déjà évoqué là, et c'était en 2015. J'avais bien retenu l'info évoquée en supervision qu'il fallait 3 à 4 ans pour remplir un cabinet, mais j'avais plus intégré le moment où il finissait de se remplir en éludant adroitement ce que ça laissait entendre sur le moment où il commençait à se remplir (sujet critique : plus il se remplit vite, moins les réserves fondent, donc plus on a de temps).
Dans ma tête, j'avais une piste (via des recommandations) pour avoir au moins quelques client·e·s dans un premier temps (avec le ralentissement de la fonte des réserves, et le bouche à oreilles, que ça implique). Dans ma tête, j'ai la chance de ne pas pratiquer une thérapie brève, donc je n'avais pas à me préoccuper de trouver des client·e·s tout le temps, la plupart de celles et ceux que j'allais trouver allaient rester. Dans ma tête, si vraiment j'étais coincé, j'allais faire une formation marketing et là les client·e·s allaient arriver, c'est quand même une formation exprès pour ça et puis je pars de zéro donc je vais nécessairement apprendre beaucoup. Dans ma tête, en dehors de l'impression des cartes du cabinet, il n'y aurait pas spécialement de dépenses à faire pour la visibilité (je sais que j'étais hors-sol à ce point parce que je l'ai écrit noir sur blanc sur mon plan de financement).
Pour ce qui est de cette première piste, ça m'a rapporté zéro client·e·s (mais ça m'aura aidé à moins stresser au lancement, ce dont j'avais besoin aussi!). Les personnes qui cherchent un·e psy ne regardent pas nécessairement l'approche parce que ce n'est pas leur expertise parce qu'iels ont une vie, donc non, la plupart des client·e·s reçu·e·s ne sont pas resté·e·s longtemps (c'est probablement l'aspect sur lequel je me suis le plus planté). Et pour ce qui est de la formation marketing, si la partie "je pars de zéro donc je vais nécessairement apprendre beaucoup" était on ne peut plus vraie (pour juste prendre l'exemple de mon site, ça va du basique pour la mise en page de la page d'accueil au plus avancé pour la rédaction du "Qui suis-je?" -non, "je faisais un métier qui n'a rien à voir et j'ai eu une révélation", ce n'est pas original, aussi époustouflant que ça puisse paraître-), ce n'est pas pour autant une baguette magique donc certes c'était indispensable mais ça n'enlève pas le besoin de temps.
Aspect qui n'arrange rien : ce qu'on met en place ne peut marcher qu'en différé (oui, décider d'aller en thérapie, ça prend du temps, choisir un·e thérapeute aussi), donc impossible d'évaluer en direct ce qui fonctionne ou non, avec les accès de découragement que ça peut impliquer. Très concrètement, j'ai eu ma première cliente à peu près deux mois après la création de l'entreprise (c'était aussi un moment magique parce que c'est le jour où j'ai récupéré le cabinet), ce qui voulait aussi dire deux mois à avoir l'impression d'être invisible même en sachant que c'est un lancement normal. Ensuite ça s'est développé très laborieusement mais ça s'est développé, jusqu'à fin mars/début avril où ça a chuté très brusquement (dont un retour de certaines semaines avec zéro consultations ce qui était dur à vivre pour moi) pour une remontée extrêmement laborieuse. L'angoisse s'est faite particulièrement intense quand l'approche des vacances d'été a coïncidé avec l'alarmante proximité de la fin de mes réserves financières : la deadline était à la fois concrète et quasi irréalisable (si le cabinet ne se remplissait pas à bloc en septembre-octobre, je devais me résoudre à rendre mon tablier). Plot twist fin juillet : j'ai finalement droit à des aides de France Travail, donc j'ai un sursis dont la durée va aussi dépendre de la vitesse à laquelle le cabinet se remplit, qui continue à être imprévisible (pour être extrêmement concret, j'ai eu des contacts sur le mois d'août et zéro depuis septembre, alors que c'est censé être l'inverse). Donc la stabilité est loin d'être acquise, mais elle reste réalisable, les mois qui arrivent le diront.
Pour faire un bilan, l'enthousiasme est toujours là, le passage à la pratique réelle tient toutes ses promesses d'épanouissement même si la nécessité de se faire payer n'est pas la partie la plus sympa, j'ai toujours autant envie de pratiquer, toujours autant envie de me former. Mais j'ai aussi découvert la difficulté de gagner en visibilité, la complexité de cette partie du travail avec une diversité énorme (parler de son activité sans endormir les autres, se préoccuper des aspects plus techniques du référencement, utiliser les annuaires ou les média publicitaires qui fonctionnent, ...), ce qui certes est intéressant mais d'une part je n'ai pas le même enthousiasme pour ça que pour l'univers de la thérapie, et d'autre part vu l'enjeu ça s'accompagne d'un stress, voire d'une angoisse, qui ne sont pas négligeables. Je suis d'autant plus remonté contre les vautours qui s'emparent de cette angoisse avec des promesses de remplir le cabinet en trois mois avec leur méthode (si si, ça existe) parce qu'à un certain stade d'inquiétude on est vite prêt·e à faire n'importe quoi (je suis convaincu que je n'aurais pas fait certains choix si j'avais pu y réfléchir plus calmement, heureusement ce n'est jamais allé loin).
Nous voilà à la fin de ce post de blog un peu détaillé et long, qui aura sûrement appris des choses à certaines personnes et aura constitué en un alignement de banalités pour d'autres. Même si j'aime râler, l'idée n'est pas tant de me plaindre (pour ça j'ai une psy en or et des amies d'une grande patience, cœur sur elles) mais de rendre visible une réalité, certes avec une grande part de subjectivité, qui n'est pas forcément la première qui vient à l'esprit quand on parle de la profession de thérapeute, ou plus généralement de réaliser sa vocation... et aussi de rendre visible cette réalité, comme je l'avais fait pour la recherche de stage en troisième année de licence, du point de vue d'une personne qui n'est pas meilleure qu'une autre et qui galère, parce que les conseils des personnes qui réussissent sont indispensables mais peuvent amener à se sentir seul·e quand on ne réussit pas ou quand on est en difficulté, alors que c'est rarement le cas, ça tend plutôt à être le contraire. Mon adresse mail est d'ailleurs pleinement dispo si vous souhaitez échanger sur ce sujet, que vous soyez dedans ou que vous hésitiez à vous lancer.
Si vous souhaitez me donner un coup de pouce, vous pouvez bien entendu m'envoyer des client·e·s O:) ou plus simplement parler de moi, je reçois en cabinet sur Lyon et en visio dans le monde entier, en français ou en anglais, ou vous abonner à ma page Facebook et liker-commenter-partager les contenus (c'est du plus long terme mais c'est bien aussi, et puis j'essaye de faire des contenus intéressants!).
Mon site : https://www.gt-therapeuteacp-lyon.fr/
Ma page Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61559172222596