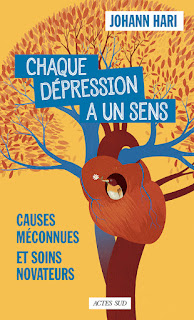L'auteur est dépressif depuis l'adolescence. Rien de très préoccupant du moment que c'est diagnostiqué : c'est juste un déficit en sérotonine, il suffit d'une prescription d'antidépresseurs et hop, bouclier magique à volonté. Bon, au bout d'un moment, ça ne marche plus, mais c'est parce que c'est le moment d'augmenter la dose. Les effets secondaires sont moyennement agréables, mais c'est un prix dérisoire à payer quand il suffit d'avaler un comprimé pour se sentir bien.
Sauf que... l'hypothèse du déficit en sérotonine comme cause de la dépression paraît cohérente, voire évidente, mais ne repose pas, scientifiquement, sur des bases solides (d'ailleurs, pour certain·e·s interlocuteur·ice·s de l'auteur, dépression et anxiété sont des symptômes différents de la même pathologie, même si l'auteur évoquera la dépression sur l'ensemble du livre). Plus préoccupant, et des méta-analyses reprenant l'ensemble des données disponibles l'ont confirmé formellement, la démonstration de l'efficacité des antidépresseurs repose sur le biais de non-publication (un biais fréquent dans les recherches commandées par l'industrie pharmaceutique : les études publiées ne mentionnent pas le résultat des études qui n'ont pas eu le résultat escompté, et surtout ne mentionnent pas leur quantité). Si l'auteur semble estimer que les antidépresseurs doivent continuer d'être prescrits parce que c'est nécessaire dans des cas particulièrement graves (mais jamais comme une solution unique et suffisante), d'autres interlocuteur·ice·s sont plus critiques dans la mesure où, si les effets positifs sont litigieux, les effets secondaires sont largement établis. Comme vous l'imaginez, Johann Hari a été particulièrement secoué par cette découverte, allant à l'encontre de la conviction qu'il avait toujours eue et qui le concernait très directement. C'est peut-être pour ça que cette partie est particulièrement détaillée, les arguments contre sont pris au sérieux et réfutés avec exigence.
Mais si ce n'est pas la sérotonine, c'est quoi? Ça tombe bien, l'auteur est journaliste et va donc pouvoir enquêter. D'ailleurs, dans le "c'est quoi", il y a des critères sociaux, et il est transparent sur le fait que sa situation est privilégiée et loin d'être accessible à tout le monde (il gagne bien sa vie, et peut prendre son temps parce que son livre précédent s'est bien vendu). En effet, ça ne va probablement estomaquer personne mais le livre fournit plusieurs chiffres pour le confirmer, la pauvreté, mais aussi la précarité, démultiplient les risques d'anxiété ou de dépression (l'expérimentation d'un revenu universel de façon très localisée au Canada a eu un effet significatif sur le bien-être, bien sûr parce que le niveau de vie était meilleur, mais peut-être encore plus parce que le revenu ne risquait pas de disparaître du jour au lendemain -même si c'est ce qui s'est finalement passé quand l'expérimentation a été arrêtée- et parce que les personnes concernées n'étaient plus contraintes d'accepter, pour subvenir à leurs besoins fondamentaux, un travail qui pouvait les briser physiquement ou psychologiquement). Autre critère : l'auteur fait quelque chose qui a du sens pour lui, par opposition à l'une des personnes interrogées qui fait un travail extrêmement ennuyeux et répétitif mais gagne bien sa vie, et n'ose pas prendre le risque, même si le dilemme est récurrent, de démissionner pour un projet moins sécurisant mais qui lui convient mieux. En revanche, si la pauvreté est en soi une menace pour la santé mentale, l'obsession pour la richesse peut l'être aussi : la recherche d'un statut toujours plus élevé impose généralement de rentrer dans une compétition du statut pour le statut, autre forme de précarité qui a l'avantage (non négligeable!) de ne pas menacer matériellement (changer sa Bentley pour une BMW, ce n'est pas tout à fait pareil que ne pas mettre le chauffage en hiver ou être expulsé·e de son logement) mais génère un stress constant et une menace pour l'estime de soi qui devient dépendante de la domination sur les autres.
L'auteur liste plusieurs causes, celles que j'ai évoquées plus haut, le manque de contact avec la nature (Johann Hari est lui-même un citadin convaincu et traîne des pieds, au propre et au figuré, quand la personne qu'il interviewe pour son enquête répond à ses questions au cours d'une randonnée en montagne), la perte d'espoir et le sentiment d'impuissance, des causes biologiques (qui ne seront pas la cause mais renforcent la vulnérabilité), des traumatismes vécus dans l'enfance (l'auteur est lui-même concerné, et l'antidépresseur comme réponse à tout l'empêchait aussi de remettre en question sa narration estimant que les adultes avaient fait leur possible et que personne n'était vraiment responsable à part lui), l'absence de considération sociale... Et, pour lui, la meilleure réponse à apporter à tout ça est la relation. Il donne entre autres l'exemple d'un mouvement social contre une augmentation du prix des loyers dans un quartier pauvre à Berlin qui a tissé des liens forts entre des voisin·e·s qui ne se parlaient pas (hippies, imigré·e·s plutôt conservateur·ice·s, militant·e·s LGBT, ...), de la création d'un jardin par une vingtaine de volontaires patient·e·s d'un hôpital psychiatrique (qui redonne une sensation de pouvoir d'agir avec la réalisation d'un projet, génère un contact avec la nature si limité soit-il, et surtout amène de fait à entrer en relation parce qu'il faut s'organiser et prendre des décisions en équipe).
Le livre a un regard social marqué, qui est d'ailleurs très explicite par endroits, en particulier dans la conclusion : oui, ce sont des individus qui souffrent de dépression, mais la société est pathogène. Il convient de lutter, individuellement, contre certaines injonctions sociales (pour aller très, très, très vite, moins rester enfermé·e chez soi et peut-être se demander si c'est si important que ça, pour les personnes qui sont en position de se poser ce genre de questions, d'avoir une résidence secondaire avec piscine dans un endroit dont le nom sonne bien), mais l'enjeu de protections sociales (beaucoup!) plus solides, d'une répartition infiniment plus égalitaire des revenus, est transparent (une des personnes dont l'histoire est racontée rétorque d'ailleurs, alors que l'équipe soignante l'oriente vers une assistante sociale, qu'il aurait surtout besoin du salaire d'une assistante sociale). Est-ce que l'auteur, dans une sorte de discours décliniste aux accents progressistes (la nature c'est bien la civilisation corrompt, les gens sont aveuglés par l'argent -mais pas moi parce que moi je suis lucide- et passent leur temps repliés sur leur téléphone au lieu de se parler -alors qu'avant les transports en commun étaient de hauts lieux de convivialité-), ne brandit pas la dépression et l'anxiété pour raconter ce qu'il a envie de raconter?
La question, à mon avis, se pose (c'est d'autant plus souhaitable pour moi d'être vigilant que je partage souvent les convictions exprimées par l'auteur), mais de nombreux éléments sont rassurants. L'auteur multiplie les interlocuteur·ice·s, source énormément les éléments avancés (et invite explicitement le·a lecteur·ice à examiner les sources de façon critique), et surtout ne verse jamais dans l'angélisme dans les exemples qu'il donne (oui, les liens sont très resserrés dans les communautés amish et ça a des effets positifs observables qui ont poussé l'auteur à revoir ses préjugés, mais ils ont aussi un regard très indulgent sur les violences intrafamiliales, oui, le mouvement social à Berlin a eu des effets spectaculaires et a été source de belles histoires particulièrement inspirantes, mais il y a aussi eu des échecs et de l'épuisement, et certaines personnes homophobes sont restées homophobes, coopération active avec des militants gays ou non). Certes les différentes démonstrations sont d'une solidité inégale (l'argumentation sur l'effet destructeur de la recherche d'un statut social toujours plus élevé est très convaincante mais s'appuie principalement sur... l'observation du comportement de singes), mais le travail en amont reste toujours conséquent et donne la sensation que, si l'auteur avait obtenu des informations différentes, il aurait aussi eu une conclusion différente. Et, comme évoqué plus haut, il fournit les éléments pour explorer et questionner son travail.
Si je devais quand même avoir une réserve sur, justement, l'aspect potentiellement séduisant du discours, c'est sur le risque d'un renforcement de la stigmatisation des personnes dépressives. En effet, beaucoup de personnes dépressives, du fait de stéréotypes répandus, entendent bien trop souvent qu'elles se complaisent dans leur état par ailleurs pas si grave que ça, qu'il suffit de penser positif et/ou de marcher en forêt et de faire du yoga (ou, encore mieux, de faire du yoga dans la forêt), que les médicaments qui potentiellement leur ont sauvé la vie entraînent une complaisance dans le statut de malade... L'auteur ayant lui-même souffert de dépression depuis son adolescence, je ne pense pas une fraction de seconde qu'il adhère à ce type de discours, mais un chapitre ou une section supplémentaire consacrée à la réalité du vécu dépressif aurait peut-être été une prévention salutaire : le discours porté est, littéralement, que marcher en forêt ou sortir d'un sentiment d'impuissance, ça aide, ce qui est probablement vrai, mais est une information qui risque d'être très mal interprétée ("c'est un élément qui est à prendre en compte parmi une infinité d'autres" peut vite se voir transformé en "il suffit de") dans un contexte de stigmatisation, contexte qui est précisément renforcé par le modèle de société axé sur la performance qui est dénoncé.