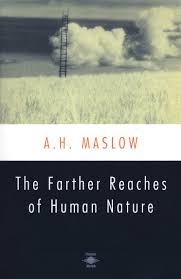Féminité en partie
définie par l’envie du pénis, homoparentalité ou PMA qui
promettent mille troubles psychiques en empêchant d’intégrer la
différence des sexes et des générations, pathologisation de tout
écart à l’hétérosexualité, fonctionnement vertical,
épistémologie faillible… un peu plus d’un siècle après sa
naissance, la psychanalyse fait l’objet de nombreux reproches, pas
toujours injustifiés ("on pourrait croire dans un premier temps
qu’il s’agit d’égarements épars de quelques analystes. Mais
nous entendons régulièrement de telles théories lors de nos
congrès internationaux"). L’autrice propose de dépasser ces
limites, et ce sans dénaturer la psychanalyse puisque l’essentiel
de son argumentation passera par un retour à Freud. Le complexe
d’Œdipe,
en particulier, n’est plus vu comme un passage figé du
développement ("il serait plus adapté de définir la structure
psychique "mature" comme un potentiel
au complexe d’Œdipe
complet et de son
"déclin", soumis à une réactualisation pendant toute la vie").
Ce retour à Freud n’empêchera pas nécessairement de le critiquer
frontalement, en particulier en rappelant que sa vision de l’orgasme
vaginal comme seul orgasme féminin valide par opposition à
l’orgasme clitoridien, pathologisé, va à l’encontre de l’état
de la science à son époque.
Appuyée
par de nombreuses références de recherches et de méta-analyses,
l’argumentation dans le chapitre sur l’homoparentalité rappelle
que les enfants de parents homosexuels ne se portent ni mieux, ni
moins bien, que ce soit dans le cadre d’un couple parental ou d’une
mère célibataire. Une partie de l’argumentation porte sur le fait
que l'éducation par des parents homosexuels ne change pas fondamentalement l'exposition quotidienne au masculin et au féminin… sans questionner une seconde
ces notions (au point que
la "différenciation des rôles parentaux"-en
substance, la mère suffisamment bonne est apaisante, le père est
castrateur- est "de
toutes façons inévitable"),
ce qui peut paraître surprenant dans le cadre d’un livre qui a
pour ambition explicite de s’opposer à des dogmes canoniques. On
peut aussi s’étonner du fait que la transidentité est à peine
évoquée (seul l’avis de Laplanche, déjà ancien, est rapporté)
alors même que, sur ce sujet, en cas d’ignorance et pas seulement chez les psychanalystes, les préjugés vont souvent combler les
vides laissés par l’incompétence, avec des conséquences
cliniques potentiellement dangereuses.
Au
niveau méthodologique, plusieurs points sont abordés, dont une
comparaison intéressante entre l’approche freudienne (fournir un
cadre sécurisant, garantissant du temps pour s’exprimer et le
non-jugement de l’analyste) et l’approche lacanienne où
l’analysant·e est bien plus bousculé·e, les limites de l’étude de
cas qui sont un récit très influencé par ce que l’analyste,
alors narrateur·ice, veut mettre en valeur (tout en rappelant les défauts
du verbatim -disparition du langage corporel, du contenu des séances
précédentes, ...-), ou encore le fonctionnement institutionnel
grippé par une trop grande verticalité, du fait des effets de
transferts omniprésents ("l’approche psychanalytique, sous-tendue
par le transfert, imprègne donc grandement la vie institutionnelle")
et des postes de pouvoir trop longtemps conservés par les mêmes
personnes. Je n’ai toutefois pas pu m’empêcher de grincer des
dents en constatant que l’aspect irréfutable de la psychanalyse,
soit sa critique méthodologique la plus sérieuse, n'est à aucun
moment évoqué, alors même que le livre contient des affirmations
telles que "le sein, par
exemple, est investi sexuellement par les adultes au-delà de sa
fonction de nourrir. L’adulte, à la différence de l’enfant,
doté d’un inconscient sexualisé, signifiera -à travers le regard
par exemple- à l’enfant la signification sexuelle du sein.
L’enfant pourrait se demander : qu’est-ce qu’on me veut
quand je prends le sein? Que voient les adultes en plus?".
On a donc des adultes qui perçoivent inconsciemment une connotation
sexuelle dans un geste du quotidien (quand je fais mes lacets, est-ce
que je trouve ça inconsciemment sexualisé parce que des fois les
doigts sont utilisés dans un contexte érotique? est-ce que je le
signifie inconsciemment aux gens qui sont autour de moi? est-ce que la
douleur de ne pas avoir de réponse à cette question est un
masochisme refoulé que je transmets par une aura d’érotisme
inconscient?), qui le communiquent, mais sans le savoir, à un
bébé, qui à son tour recevra cinq sur cinq toute cette sensualité
(alors qu’à la base il avait probablement surtout faim et soif)
pourtant exprimée, a
priori, de façon
obscure : l’affirmation est tellement irréfutable qu’on
pourrait la croire écrite exprès pour troller Karl Popper.
Le
livre, par sa démarche, ses qualités et ce que je perçois comme
des lacunes, a donc le mérite à la fois de montrer que la
psychanalyse peut être modernisée et critiquée, et qu’elle est
critiquable. Les chapitres abordent des sujets assez diversifiés et
offrent, si les réponses
ne sont pas toujours parfaitement convaincantes,
des questionnements intéressants.