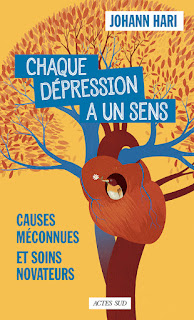Dans ce court livre réédité en 2016, l'auteur et l'autrice proposent une présentation, contextualisée historiquement, du monde et des représentations du travail et leurs enjeux sur le psychisme, les principaux risques pour la santé mentale, les éléments sur lesquels porter son attention dans les accompagnements, ...
La structure est fonctionnelle, la présentation plutôt complète (la présentation des institutions est un peu obsolète puisque les CHSCT n'existent plus, mais ça a eu lieu 4 ans après la dernière édition). Certains regards sont intéressants comme l'interaction entre individuel et collectif, ou encore la dimension corporelle : l'exemple est donné d'ouvrier·ère·s qui jouaient au Scrabble et culpabilisaient de le faire sur leur temps de travail, mais en regardant de plus près il s'avère que leur vigilance ne baisse pas puisque leur ouïe est tellement habituée au fonctionnement habituel des machines que le moindre signal inattendu est perçu immédiatement, le jeu de société permet au contraire de ne pas avoir une attention qui baisse du fait de l'ennui. Cette dimension corporelle est bien sûr présente dans d'autres domaines de travail, comme les soignant·e·s qui vont avoir une vigilance ancrée sur une infinité d'éléments à surveiller pour mieux anticiper la nécessité d'agir. Le respect de la compétence et du savoir est également évoqué : une contrainte nouvelle venue d'en haut pour faire augmenter la productivité peut avoir un impact important sur la santé mentale des personnes concernées, d'autant qu'elle pourra être inadaptée à la réalité matérielle du travail.
Si j'ai listé des éléments plutôt objectifs et généralisables, l'auteur et l'autrice s'attachent à proposer un regard qui part de la subjectivité des personnes étudiées. L'idée a bien entendu tout son intérêt, on peut le constater en particulier dans le chapitre consacré à l'accompagnement thérapeutique, où il est recommandé de mettre ses représentations de côté ce qui a, par exemple, les avantages bien concrets de ne pas comprendre de travers un univers où la personne accompagnée passe une partie conséquente de son quotidien donc qu'elle seule sera à même de décrire de façon satisfaisante, ou encore de sortir de la demande d'alliance qui est souvent le point de départ pour être à la place dans une recherche de compréhension, qui permettra un regard plus complet. Seulement, pour donner cette place à la subjectivité, l'auteur et l'autrice brandissent la psychanalyse comme outil de compréhension principal, une psychanalyse qui sera par ailleurs plutôt poussiéreuse.
Il sera ainsi question d'investissement libidinal et de décompensation là où près d'un siècle de psychologie a donné des apports entre temps. Des citations de Freud de 1905 et de 1911 seront partagées sans aucun recul, avec des fulgurances comme "de cette aversion pour le travail qu'ont les hommes, découlent les problèmes sociaux les plus ardus" ou encore "l'éveil prématuré de la sexualité sous l'effet du caractère séducteur du soin maternel" (les femmes, ces fameuses séductrices compulsives... les victimes d'inceste seront par ailleurs ravies de lire que ce qu'elles ont vécu ce n'est pas fondamentalement différent des contacts inhérents aux soins d'hygiène du quotidien). Le sexisme est d'ailleurs mentionné de façon particulièrement ambivalente, avec parfois des dénonciations claires par exemple en rappelant plusieurs de ses conséquences ou encore que la naissance d'un enfant n'aura pas du tout le même impact sur la sphère professionnelle d'un homme que sur celle d'une femme, et d'autres fois des énormités particulièrement violentes comme l'idée qu'une ambiance sexisme malaisante est une défense (oui, on est dans la psychanalyse) sur fond de sadisme masculin et de... masochisme féminin (pauvre Christine Delphy, sociologue et militante féministe citée quelques lignes avant ce trait de génie), ou encore que dans les accompagnements thérapeutiques ce n'est pas trop la peine de se préoccuper de ces sujets parce que "l'élaboration de ces rapports de domination-servitude est souvent rudimentaire, en particulier chez les femmes qui arrivent en consultation après un parcours jalonné depuis longtemps de discriminations" (on les aiderait bien, ces bonnes femmes, mais elles sont tellement cruches!). Le racisme, extrêmement violent dans le monde du travail, et le validisme, sur lequel il y aurait énormément à dire puisque les attentes de productivité sont basées sur la norme de personnes non porteuses de handicap, n'auront pas droit à un tel traitement puisqu'ils ne sont même pas mentionnés.
J'évoquais l'obsolescence de la mention des CHSCT, mais comme je viens de le souligner, c'est bien pire au niveau théorique, au point qu'on pourrait souvent croire que le livre a été écrit dans les années 50 ou 60 (ce qui n'excuserait pas par ailleurs les énormités sexistes)... et je ne dis pas ça parce que le référentiel est psychanalytique, puisque comme je l'ai dit des références du tout début du XXème siècle sont citées sans aucune distance (je ne serais pas surpris que même Freud soit revenu sur ou ait nuancé certaines de ses citations qui figurent dans le livre). Le format court et synthétique était bien vu, mais pour autant je recommanderais d'aller voir ailleurs!